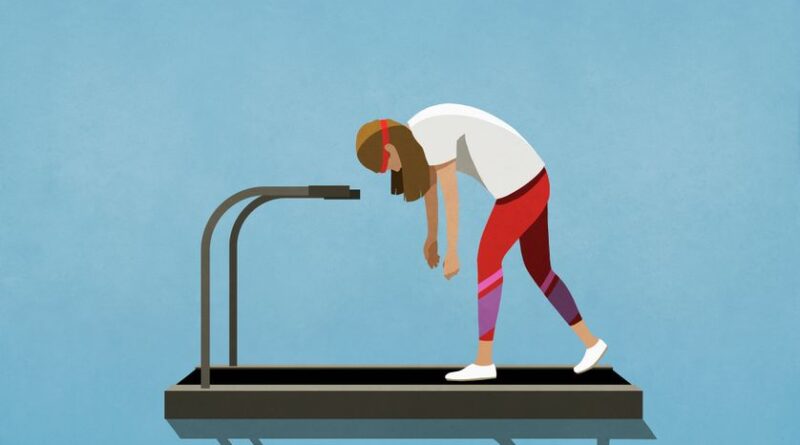Pourquoi penser à la mort quand je fais du sport?
L’hypothèse la plus probable, c’est à cause de la mort subite du sportif …
Le sportif et la mort
De la mort de Marc-Vivien Foé, dans le rond central du stade de Gerland, en 2003, à celle de Michel Berger sur un terrain de tennis, en passant par celle d’Olivier Ferrand, le président de la fondation Terra Nova; ce sont toujours des morts dont on se rappelle, pour leur côté paradoxal sans doute: le sport est associé plutôt à la bonne santé cardiovasculaire.
Mais il y a aussi l’existence, cela vaut surtout pour le vélo ou l’alpinisme, d’un grand répertoire d’accidents – sans aller jusqu’au 0,04% de mortalité par saut en wingsuit.
Dessiner son parcours sur une carte, avant une sortie cycliste, a ainsi quelque chose de divinatoire: il existe une conversation non nulle qu’on passe avec le crayon ou le doigt à l’endroit de sa mort. Cela fait en général que je dors mal, avant d’aller faire du vélo.
Il y a une angoisse du sportif, mais la peur de la mort disparait dès les premiers coups de pédale. Et courir apporte une sérénité mentale qui désactive absolument la peur de la mort – mort à laquelle on se met à penser, à l’opposé des mauvaises pensées qui assaillent le cerveau de l’insomniaque, avec une indifférence insolente.
On fait par exemple des calculs, dans lequel la mort joue un rôle étrange: celui du signe égal, comme si tout était soudain indifférent: et si je cours encore pendant 40 ans, dix kilomètres par jour, cela m’amène à combien? La multiplication par 365, puis par 40, n’est pas une chose facile, cela peut nous tenir quelques centaines de mètres – quelques centaines de mètres qui nous rapprochent résolument de la mort.
Le paradis blanc
Je suis arrivé à 146 000 kilomètres: presque la moitié de la distance Terre-Lune, c’est plutôt honorable.
Voilà mon objectif.
Ou plutôt la limite, la distance que je suis certain de ne jamais atteindre.
Et cela ressemble à cette idée asymptotique qu’on se fait souvent de la mort.
J’en suis à peine à 3 500 kilomètres: c’est comme si la mort était à plus de 140 000 kilomètres de moi. Il me suffirait de ralentir toujours pour ne mourir jamais.
Idem pour le vélo: quelqu’un qui ferait 100 kilomètres par jour pendant 40 ans parcourrait un million et demi de kilomètres. C’est un centième de la distance Terre-Soleil. Ce fameux Soleil qui comme la mort ne peut se regarder en face, et dont je reste loin: je n’ai même pas fait encore la moitié d’un tour de la Terre.
Et j’ai testé plus de marge que je ne cesse de ralentir, comme tous ces sportifs du dimanche, qui ont attendu comme moi d’arrêter de fumer ou d’avoir des enfants pour se mettre au sport – pour s’y mettre à l’âge même du déclin de leurs facultés physiologiques, à l’âge où les sportifs professionnels prennent leur retraite.
Je ne courrai jamais le marathon en moins de trois heures.
Et d’où vient pourtant que je m’y entraîne, avec une régularité religieuse, depuis plus d’un mois, tentant de courir un semi par dimanche?
D’où vient cette envie de crucifixion symbolique qui m’a conduit l’autre jour, en tremblant pied-nus dans la neige, à faire le tour du Grand Canal de Versailles? Sans doute d’un désir de résurrection.
Est-ce que je pense à la mort quand je cours, parce que je n’y crois finalement pas?
C’est cela le plus étrange, oui. Au-delà des traces que je laisse dans la neige et des données qui montent directement de ma montre jusqu’au ciel, il y a, quand on court, une telle présence du présent qu’on a l’impression d’avoir pris sa propre mort de vitesse et d’être parti en repérage dans la vie éternelle.